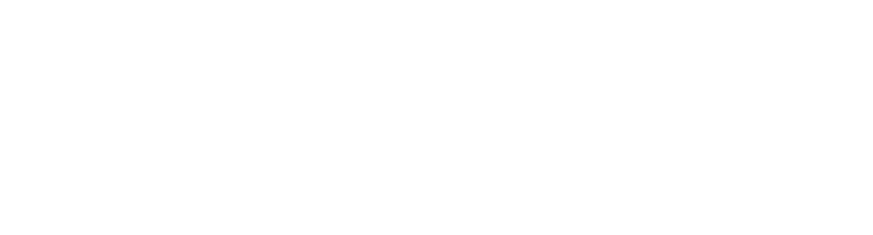Né en 1985, vit et travaille à Paris et Nice.

Jérôme Grivel s’intéresse à la faculté des corps, ou des sculptures qu’il construit, à répondre à des situations contraintes, à la recherche de ce point de rupture à partir duquel un état bascule dans un autre. S’agissant de ses Improvisations architecturales, l’affaire est entendue : cette série, initiée dès 2009, est composée de structures complexes qui, construites avec des matériaux non appropriés, finissent par s’effondrer. On contemple alors le résultat de la contorsion opérée par la matière — les tiges de métal plient mais ne rompent pas — sous l’effet de forces physiques qui accueillent un aléa.
Avec le spectateur, évidemment, la question se corse, puisqu’à l’effet mécanique se substitue la question du choix, de la prise de décision voire de la créativité. Les Structures déambulatoires de l’artiste attendent, donc, d’être complétées par les visiteurs. Il s’agit cette fois d’un assemblage de barres d’acier qui s’apparente à l’ossature d’un labyrinthe à contre‑emploi, puisque l’on ne peut s’y perdre. Ces formes strictement géométriques, minimales, ne débordent pas leur fonction de « cadre ». Mais un cadre transparent, à rebours de nos sociétés de contrôle basées sur l’induction de contraintes qui conditionnent nos modes de vie et de pensée. « Je m’intéresse à la façon dont les corps peuvent, dans une situation donnée, retrouver un espace de liberté à l’intérieur, la subir ou la détourner », explique Jérôme Grivel.
La liberté n’est pas sans choix et sans doute pas sans résistance, dans l’espace normé qu’est aussi le lieu d’exposition. Pièce de repos (2013) se présente ainsi comme un espace « semi privé », délimité par des structures de lattes en bois le dévoilant aux regards extérieurs : il offre la possibilité au spectateur de s’allonger sur une stèle légèrement inclinée, la tête plus basse que les pieds, pour entendre en direct le son à peine amplifié de l’espace d’exposition.
Enfin à ce jeu là, Jérôme Grivel ne s’épargne pas lui-même. Dans un cycle de vidéos consacré au thème du cri, on le voit s’égosiller tout en retenant le son de sa propre voix jusqu’à épuisement (Parabole #3, 2015). Ou, doté d’un casque et d’un micro connectés en circuit fermé, se hurler dans les oreilles à n’en plus pouvoir (Parabole #2, 2010). Il s’agit bien, ici, d’habiter la contrainte — puisqu’il y a toujours un cadre — et par là même d’exister, c’est-à-dire étymologiquement de « se tenir hors » d’une illusoire autonomie. Et explorer les limites.
Texte de Ingrid Luquet-Gad